Préface
La présente chronologie de Notre-Dame-du-Portage, de 1604 à 2021.
Cette chronologie est tirée du livre publié par Patrimoine et Culture du Portage en 2015 : Aubert Ouellet, La belle de l’est, souvenirs et images de Notre-Dame-du-Portage, chapitre VIII, p. 117-156.
Dans le corps du texte, les sources, le cas échéant, sont notées par les initiales des auteurs et la page de la publication d’où provient l’information.
Une version antérieure de chaque partie de cette chronologie fut publiée dans Le Louperivois, le bulletin de la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, en 2008 et 2009.
Si un lecteur possède des renseignements qui permettraient d’enrichir, de compléter ou encore de corriger le présent ouvrage, communiquez avec nous au patrimoinenddp@gmail.com
Aubert Ouellet, président fondateur de Patrimoine et culture
L’époque de la Nouvelle-France de 1604 à 1759
1604 : Champlain connaît l’existence du sentier de portage qui va de l’Acadie au fleuve Saint-Laurent. Il a laissé un témoignage du passage de trois Récollets à l’avoir parcouru. Le sentier figure sur la carte de Samuel de Champlain en 1612. Le point de départ et d’arrivée de ce « sentier des canotiers », sur les rives du Saint-Laurent, se trouve sur le territoire actuel de Notre-Dame-du-Portage. Cette antique voie de communication, où alternent les chemins d’eau (fleuve, rivières et lacs) et les chemins de terre permettant de portager les embarcations entre les cours d’eau, relie le grand fleuve à la Baie de Fundy. Pendant plusieurs siècles avant l’arrivée des Français, il est fréquenté par les Amérindiens (Malécites, Micmacs, Abénaquis et Montagnais). (PL, 98)1673 : Le 15 novembre, la Compagnie des Indes occidentales octroie la seigneurie de Terrebois, nommée aussi Verbois, à François Dionis, un bourgeois de Paris qui ne met jamais les pieds en Amérique. L’actuelle municipalité de Notre-Dame-du-Portage se situe sur une partie de cette seigneurie, d’une largeur de trois lieues (environ 12 km) de front sur le fleuve et de trois lieues de profondeur, (JO, 24)
1686 : Le 7 mai, Mgr de Saint-Vallier, âgé de 33 ans, emprunte, selon toute vraisemblance, le sentier des canotiers, au cœur de Notre-Dame-du-Portage actuel, alors qu’il entreprend une « petite expédition évangélique en Acadie », une tournée de 1 700 milles (2 735 km). (PL, 46)
1689 : Le 5 avril, Charles Aubert de la Chesnaye se porte acquéreur de la seigneurie de Verbois. Marchand, trafiquant de fourrures et financier, le nouveau seigneur est le principal homme d’affaires de la Nouvelle-France au XVIIe siècle.
1703 : Première pêche aux marsouins (bélugas) concédée à la rivière des Caps. Le premier peuplement de Notre-Dame-du-Portage est intimement lié à ce type de pêche. En effet, les artisans appelés à travailler à cette pêche prennent conscience du potentiel de ce territoire ; avec leurs proches et de nouvelles familles, ils coloniseront les terres de la petite anse sise immédiatement à l’est du dernier cap (bien que non officialisée, on y réfère par l’appellation « anse à la Friche » dans la suite de cette chronologie ; cette anse est située à l’extrémité sud-ouest de Notre-Dame-du-Portage).
1703 : L’inventaire de la seigneurie de Rivière-du-Loup effectué par Florent de la Cetière atteste de la présence de Pierre Boucher à la Rivière-des-Caps. Ce lieu-dit était alors compris dans la seigneurie de Verbois ; la partie est de ce lieu-dit se trouve aujourd’hui dans la municipalité de Notre-Dame-du-Portage et la partie ouest dans celle de Saint-André-de-Kamouraska. Pierre Boucher se portera acquéreur de la terre où baigne la rivière des Caps dix-neuf ans plus tard. (PL, 68-69)
1705 : Le 14 mars, Guillaume Paradis et Pierre Hudon dit Beaulieu, habitants de Kamouraska, obtiennent une concession de 12 arpents (0,7 km) de front sur le fleuve Saint-Laurent et de 42 arpents (2,5 km) de profondeur dans les terres, commençant vis-à-vis de l’islet à la Friche du côté nord-est en direction de la rivière des Caps. Cette concession inclut la jouissance des droits de pêche et de chasse (Greffe Chambalon, Archives judiciaires de Québec, Palais de Justice de Québec) (BB1, 77). Elle se trouve en partie dans le territoire actuel de Notre-Dame-du-Portage. Notons que la dénomination « islet à la Friche » n’a pas été officialisée par la Commission de toponymie du Québec ; dans les textes, certains parlent de l’islet à Fliche, l’islet à Friche, l’islet à Flèche et l’islet à la Friche.
1709 : À la suite d’une décision rendue par la Prévôté de Québec le 29 octobre, Joseph Blondeau dit Lafranchise succède à Aubert de la Chesnaye, décédé le 20 décembre 1702, comme seigneur de Verbois, de Rivière-du-Loup, du Parc (Cacouna), de Témiscouata et de Madawaska. Blondeau a épousé en troisième noce Agnès Giguère, elle-même veuve de Charles Le Marquis dont elle a eu un fils nommé Charles-François. C’est lui qui obtiendra les terres donnant sur l’islet à la Friche et qui deviendra l’un des premiers colons du Portage. (PL, 55)
1714 : Le 3 juin, le seigneur Joseph Blondeau concède à Jacques Guerré (ou Guéret) dit Dumont une terre et habitation de six arpents (350 m) de front par quarante arpents (2,5 km) de profondeur à l’anse des Trois Ruisseaux (BB1, 87). L’endroit porte maintenant le nom de « baie de l’Amitié », située au nord-est de l’anse du Portage, nom officialisé le 7 avril 1983 par la Commission de toponymie du Québec. Ainsi, les deux terres qui fixent aujourd’hui les limites de la municipalité, d’est en ouest, furent les premières convoitées et habitées, en raison de leur potentiel agricole et de leur proximité du fleuve. (PL, 57)
1716 : Le sieur Peire de Québec exploite une pêche aux marsouins (bélugas) à Rivière-des-Caps ; cinq ans plus tard, c’est le sieur d’Artigny qui la tient. (LS, 29)
1722 : Pierre Boucher, âgé de 58 ans, et deux de ses fils, Michel et Pierre, sont installés à Rivière-des-Caps, lieu-dit voisin de municipalité actuelle de Notre-Dame-du-Portage. Marie-Anne Michaud, que Pierre a épousée à Rivière-Ouelle le 19 juillet 1695, et leurs cinq filles viennent le rejoindre peu après. Pierre Boucher n’a jamais résidé à l’intérieur du territoire actuel du Portage, puisqu’il habitait à l’extrémité est de l’actuelle municipalité de Saint-André. Néanmoins, il a joué un rôle important avec sa famille dans le développement de Rivière-des-Caps, qui fait partie intégrante de l’histoire de Notre-Dame-du-Portage. Il n’est toutefois pas l’ancêtre des familles Boucher résidant maintenant au Portage. (LS, 33-37)
1723 : Le 13 février, le seigneur Blondeau déclare devant l’Intendant Bégon que Jean Dionne dit Sansoucy vient de commencer à travailler sa terre de six arpents sur quarante (JO, 5). Cette terre se trouve entre les propriétés actuelles sises entre le 836 et le 898 de la route du Fleuve (AB, 13). Le seigneur ajoute qu’au-dessus se trouve Charles-François Le Marquis et qu’encore au-dessus se trouve Pierre Boucher, qui viennent eux aussi de commencer à défricher leur terre (JO, 5)
1723 : Charles-François Le Marquis obtient officiellement concession de sa terre le 30 septembre. Cette terre mesure huit arpents de front (un peu moins d’un demi km) par trois lieues (environ 12 km) ; on l’a par la suite appelée le « Fief Marquis » (LS, 40). La terre de deux arpents appartenant jusqu’en 2014 à la succession d’Alphonse Beaulieu (1100 de la Montagne) et celle de six arpents d’Albert Beaulieu (1120 de la Montagne) occupent les huit arpents de front de la terre originale de Charles-François Le Marquis, sans en avoir la même profondeur. (AB, 13)
1724 : Le 20 janvier, Charles-François Le Marquis, âgé de 25 ans, épouse Marie-Anne Boucher, fille de Pierre, son voisin. (PL, 81)
1728 : Une pêche au marsouin installée par Charles-Paul Denys De St-Simon se trouve dans l’anse du Portage. (PL, 75)
1735 : Joseph-Simon Gueret dit Dumont obtient une concession de onze arpents et six perches (0,7 km) de front par quarante-deux arpents (2,5 km) de profondeur à Rivière-des-Caps. Cette terre se trouve voisine, à l’est, de celle de Charles-François Le Marquis (AB, 13)
1746 : Quelques années avant la conquête de la Nouvelle-France par l’Angleterre, les Français commencent à se rendre compte de la nécessité d’établir une voie permanente de communication entre la Nouvelle-France et l’Acadie. Pour être permanent, ce lien ne peut être que terrestre puisque les cours d’eau gèlent en hiver. L’ordre est donné de construire un chemin de 3 pieds de largeur pour les relier ; ce chemin, empruntant en grande partie de parcours de la section terrestre de l’ancien sentier de canotiers, sera connu comme le « chemin du Portage ». La même année, commence la construction de la première route le long du fleuve.
1754 : Agnès Giguère, veuve du seigneur Blondeau et mère de Charles-François Le Marquis, se départit de la seigneurie de Verbois en le vendant à Pierre Claverie, garde des magasins du Roi, associé de l’Intendant Bigot dans une entreprise d’escroquerie et propriétaire officiel du magasin « La Friponne ». Au moment de la vente, on compte quinze tenanciers à Rivière-des-Caps ; les membres du clan Dumont-Marquis-Boucher, tous reliés les uns aux autres par lien familial direct ou par alliance, se partagent une bonne partie de ces terres. À l’autre extrémité, les terres sises en bordure de l’anse du Portage ne sont pas encore complètement occupées. (PL, 85 et 87)
1756 : Fin de la mission établie à Rivière-des-Caps, avec la mort du père Quoad ou Cohade, décédé et inhumé à Kamouraska au printemps (PL, 46). On ne connaît pas la date du début de cette mission. La chapelle aurait été située entre le fleuve et la route 132, sur la terre sise au 980, route de la Montagne. (LS, 26)
1758 : Michel Morin se porte acquéreur d’une terre de quatre arpents par quarante-deux (230 m par 2,5 km) dans l’anse du Portage. Il donnera son nom au lac Morin, situé sur le territoire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. (AB, 13)
1759 : Les Anglais incendient la Côte-du-Sud de Kamouraska jusqu’à Québec. Il semble que les territoires de Rivière-du-Loup et de Rivière-des-Caps aient été épargnés. (PL, 103)
La période du régime anglais de 1762 à 1855
1762 : Le recensement de 1762 dénombre 50 personnes dans la seigneurie de Rivière-du-Loup. Quatre familles ont leur résidence sur le territoire actuel du Portage, soit celles de Jean Autin, François Lambert, Antoine Morin et Jean-Baptiste Bourgoin (EP, 52). C’est dire que Rivière-des-Caps, qui comptait déjà 16 propriétaires en 1754, s’est développée à peu près au même rythme que Rivière-du-Loup jusqu’à la Conquête. (PL, 111)1763 : La veuve de Pierre Claverie, Marie-Anne Dupéré remariée à Nicolas-Antoine Dandane-Danseville de L’Étendard, vend la seigneurie de Verbois à James Murray, premier gouverneur anglais de Québec. (JO, 27)
1775 : Avec la guerre d’Indépendance des États-Unis, les liaisons postales entre Québec, Montréal et New York sont interrompues. Le portage du Témiscouata s’avère une voie de communication officielle des plus utiles entre les colonies maritimes, Québec et Londres. (PL, 104)
1781 : En mai, Henry Caldwell, militaire et homme d’affaires né en Irlande vers l’année 1735 et membre de l’état-major du général Wolfe lors de la prise de Québec en 1759, devient détenteur d’un bail à ferme de la seigneurie de Verbois, un privilège qu’il détiendra pendant 21 ans. (EP, 50)
1783 : Le gouverneur Haldimand décide de faire du chemin du Portage construit par les Français en 1746 une véritable route praticable douze mois par année. Le 13 juin, 197 hommes, dont 25 de Rivière-des-Caps, se mettent au travail, partant d’un point proche de l’ancien tracé du sentier, au cœur de la municipalité actuelle de Notre-Dame-du-Portage. Après 18 jours de travail, ils atteignent la rivière du Loup. Ils se font alors relayer par un autre contingent de 300 hommes qui œuvre jusqu’au 20 juillet. Pendant trois ans, soldats et miliciens se succèdent pour terminer le travail. (PL, 104-105)
1787 : La nouvelle voie élargie du chemin du Portage, mesurant de 22 à 24 pieds (6,7 à 7,3 mètres), avec des fossés de chaque côté, est enfin praticable par des voitures à cheval. Le géographe François-Joseph Bouchette, dans sa carte de 1832, désigne ce chemin comme le « chemin du Grand-Portage ». (PL, 105)
1791 : Le diocèse de Québec divise le territoire qui va de l’Islet-du-Portage jusqu’à l’extrémité est de Rivière-du-Loup en deux paroisses : Saint-André, qui comprend l’Islet-du-Portage et Rivière-des-Caps, tandis que Rivière-du-Loup hérite du reste du territoire. Le chemin du Portage constitue la ligne de démarcation entre les deux paroisses. Par cette décision, l’Église « s’autorise à gommer deux appellations civiles connues et utilisées depuis bientôt 70 ans : l’Islet-du-Portage et Rivière-des-Caps. Toutefois, le nom de Rivière-des-Caps va continuer d’être utilisé autant dans les documents officiels que dans les récits des voyageurs ». (PL, 114)
1798 : Toutes les terres allant de la rivière du Loup jusqu’au chemin du Lac sont maintenant concédées. (PL, 115)
1802 : Le 21 juin, vente de la seigneurie de Verbois par la succession de James Murray à Henry Caldwell, qui détenait un bail à ferme sur la seigneurie depuis 1781. (JO, 27)
1802 : Le 2 août, vente de la seigneurie Verbois par Henry Caldwell à Alexander Fraser, trafiquant de fourrures et deuxième fils du colonel Malcolm Fraser. Caldwell n’aura été le véritable propriétaire de la seigneurie que pendant 42 jours. Alexander Fraser viendra résider à Rivière-du-Loup vers 1806, après un séjour dans les Territoires du Nord-Ouest. (JO, 27-28)
1815 : L’arpenteur François-Joseph Bouchette fait état de l’existence d’une auberge à Rivière-des-Caps. Il s’agit de celle de madame Perron, au bas de la côte du Portage, à peu de distance du point d’arrivée du chemin du Grand-Portage. (PL, 122 et 244-245)
1825 : Le long du chemin du Lac, 50 lots sont déjà concédés, occupés par un nombre important de personnes qui auront bientôt leur mot à dire dans les affaires de la paroisse. Sur tout le territoire actuel de Notre-Dame-du-Portage, les métiers continuent de se développer. D’ailleurs, dans le secteur de Rivières-des-Caps, dès la fin du régime français, on trouve déjà des artisans, charpentiers, menuisiers, maçons, fondeurs d’ustensiles, forgerons, scieurs de long. Il y a même un chantier maritime actif pendant longtemps ; on y construit des goélettes à voiles destinées au transport commercial entre la région et Québec. (LS, 21)
1826 : Joseph Boucher est le forgeron du Portage. Il succède à Éloi Dion (Hion). Plusieurs autres suivront, dont François Marquis (1840), Jean-Baptiste Caron, Benjamin Michaud, Isaïe Michaud, Oméril et Adjutor Michaud, Théophile Pelletier et son fils Louis-Étienne et, le dernier, Roger Dickner. (AB, 48)
1846 : Le 6 mars, trois résidents du Chemin-du-Lac, Jean-Baptiste Caron, Jean-Marie Leclerc et Élie Michaud, sont les premiers à demander à l’archevêque de Québec, Mgr Joseph Sinaï, la formation d’une paroisse entre celles de Saint-André et de Rivière-du-Loup. (EP, 81)
1848 : Le 19 janvier, une nouvelle démarche dans le même sens est effectuée auprès du secrétaire de l’archevêque, l’abbé Charles-Félix Cazeau, par 18 signataires. La demande restera en panne pendant encore sept ans. (EP, 81-82)
1854 : Le 29 octobre, l’abbé Narcisse Beaubien, curé de Rivière-du-Loup, écrit à Mgr Charles-Eugène Baillargeon, évêque de Québec, le suppliant de créer une nouvelle paroisse entre celles de Saint-André et de Rivière-du-Loup, afin de mettre fin aux nombreuses insatisfactions des pratiquants concernant la localisation des églises et leur zone de desserte. L’abbé affirme : « La très grande majorité [...] reviendra à ses devoirs religieux ; autrement, Monseigneur, je ne puis m’attendre [...] qu’à voir un bon nombre ne plus aller à l’église, et cela peut-être pour longtemps.» (EP, 82-83)
1855 : Le 27 février, l’abbé Beaubien, ayant reçu l’approbation de principe pour la création d’une nouvelle paroisse, confirme à l’évêque qu’il va donner suite à sa requête de procéder à la « marcation » d’une église au Portage et demande à son supérieur d’envoyer les avis pour les publier « dès dimanche prochain, pour ensuite tirer le bois nécessaire ». L’abbé reçoit les deux avis et les affiche les 11 et 18 mars. On convoque une assemblée chez Benjamin Michaud, le 22 mars, à 9 h. Une vigoureuse opposition de la part des habitants de Saint-Patrice (comprendre ceux de l’anse du Portage) et de ceux de Saint-André (comprendre ceux de Rivière-des-Caps) se manifeste quant à l’endroit où sera située l’église projetée. Malgré tout, le projet va de l’avant. (EP, 84-89)
1855 : Le 30 mai, l’évêque charge l’abbé Beaubien de construire une chapelle provisoire au Portage, pour être placée sous le vocable de l’Immaculée-Conception de la Vierge Marie (dont le dogme vient d’être proclamée le 8 décembre 1854). Cette désignation de l’évêque, combinée à la présence sur le territoire du chemin du Portage (ou « chemin du Grand-Portage » selon Bouchette), est à l’origine du nom de la paroisse et de la municipalité de Notre-Dame-du-Portage. (EP, 93)
1855 : Le 1er novembre, la première messe est célébrée à Notre-Dame-du-Portage par l’abbé Narcisse Beaubien, dans une chapelle servant de lieu de culte jusqu’en octobre 1861. Cette chapelle sera ensuite transformée en presbytère. (EP, 93)
1855 : Le 11 décembre, l’abbé Léon Roy, curé de Trois-Pistoles, bénit solennellement la première cloche, pesant 450 livres (204 kg), sous les prénoms de Marie-Anne-Octave. (EP, 90)
Les premiers cents ans de la municipalité de 1856 à 1956
1856 : Le 19 juillet, émission à Toronto des lettres patentes de la municipalité par le Gouverneur général, Sir Edmund Head, au nom de sa Majesté la Reine Victoria, alors que Georges-Étienne Cartier est « Attorney General ». Ces lettres patentes sont publiées en anglais seulement, dans « The Canada Gazette », le 26 juillet, Benjamin Michaud devient le premier maire de Notre-Dame-du-Portage.1856 : Le 1er septembre, Benjamin Michaud devient le premier maître de poste dans la municipalité. (AB, 69)
1857 : Le 1er mars, une réunion se tient pour demander l’autorisation de s’assembler pour nommer les syndics devant diriger la construction de l’église, de la sacristie et du presbytère. La demande est entérinée le 1er mai suivant par le premier desservant de la paroisse, l’abbé Joseph-Elzéar Michaud. (EP, 94-96)
1857 : Le 27 juillet, formation de la commission scolaire, présidée par le maire Benjamin Michaud. (PL, 232)
1858 : Installation du premier curé résident de Notre-Dame-du-Portage, l’abbé Esdras Rousseau. (EP, 103)
1858 : Contrat accordé aux associés Charles Bernier de Cap-Saint-Ignace et Philippe Fortin de la paroisse Saint-Thomas de Montmagny pour la construction de l’église, de la sacristie et du presbytère, pour le montant de 6 700 $, à payer comme suit : 800 $ pendant huit ans et 320 $ (sic) la dernière année. (EP, 100-101)
1859 : Le 21 juillet, bénédiction de la pierre angulaire de l’église. La construction de l’église au centre de la nouvelle paroisse sera terminée en 1863. On déménage dans le stationnement actuel une maison à peu près neuve pour servir de presbytère pendant la construction de l’église. (EP, 98) Ce bâtiment servira plus tard de salle publique. (PL, 232)
1860 : Mise en service du chemin de fer jusqu’à Rivière-du-Loup. Des familles anglophones de Québec, de Montréal et de l’Ontario commencent à affluer au Portage. (PL, 265)
1862 : Jean-Baptiste Caron succède à Benjamin Michaud comme maire. (AB, 26)
1864 : Louis Léveillé devient maire de la municipalité et Martial Michaud, secrétaire- trésorier, succédant à Benjamin Michaud, fils. (AB, 26)
1866 : Jean-Baptiste Caron entreprend son deuxième mandat comme maire et Marcel Caron devient secrétaire-trésorier. (AB, 26)
1868 : David Beaulieu accède à la mairie. (AB, 26)
1869 : Entre 1869 et 1877, on procède à la construction de quatre écoles, l’une près de l’église, une deuxième dans l’anse du Portage, une autre dans l’anse à la Friche et une quatrième au Chemin-du-Lac. Jusqu’à l’ouverture des écoles, l’enseignement est dispensé dans des maisons privées. (PL, 233)
1870 : Pierre Caron est élu maire. (AB, 26)
1871 : Le recensement de 1871 indique que la municipalité compte 850 personnes, réparties dans 166 ménages.
1872 : Louis Gagnon succède à Pierre Caron à la mairie. (AB, 26)
1873 : Le 30 septembre, l’archevêque de Québec, Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau, émet une ordonnance épiscopale rappelant aux paroissiens de Notre-Dame-du-Portage que « Jusqu’à présent, les dîmes et offrandes ordinaires ont à peine suffi pour donner à votre Curé le strict nécessaire » ; que « depuis l’établissement de votre paroisse, la dîme a diminué d’année en année » ; que « Dorénavant, à dater de cet automne, le Curé percevra le Supplément de foin à la 26e botte et le Supplément de patates au 26e minot. Ce double supplément sera dû à Pâques, comme la dîme » ; que « le présent supplément étant dû par religion, par obéissance et par justice, quiconque refusera de le payer, se rendant coupable de péché, ne peut être admis aux sacrements de l’Église, même à l’article de la mort, à moins qu’il ne soit repentant de sa faute, et disposé à la réparer dès qu’il le pourra ». (EP, 118-119)
1874 : Ernest Ouellet est nommé secrétaire-trésorier de la municipalité. (AB, 26)
1875 : Le 27 avril, des paroissiens ayant refusé de se conformer à l’ordonnance de l’archevêque, le vicaire général, Mgr Cazeau, écrit au curé Constantin : « ...ces 8 ou 9 paroissiens qui refusent de payer le supplément [...] doivent être traités comme le serait tout autre paroissien qui serait connu publiquement comme refusant de payer la dîme légale. [..] Si quelqu’un d’entre eux venait à mourir subitement, sans avoir exprimé de regret de sa révolte, vous vous trouveriez dans la dure nécessité de lui refuser la sépulture ecclésiastique. Il est bon de les éclairer sur les résultats que pourrait avoir leur désobéissance. (EP, 120-121)
1875 : Ernest Labbé, aussi boucher de son état, ayant pris la relève de son père Arthur, exploite l’Hôtel Labbé, le premier véritable établissement hôtelier du Portage. Cet établissement devient quelques années plus tard l’Hôtel Beaurivage ; il existe toujours sous le nom d’Auberge sur Mer. En 1915, Luc April, chanteur et conteur, ami de Marius Barbeau, en fait l’acquisition ; il la confie en 1918 à son fils Ludger-Ovide qui l’administre pendant 47 ans. Jean, fils de Ludger-Ovide, l’exploite ensuite pendant de nombreuses années. (PL, 265)
1876 : Isaïe Michaud devient secrétaire-trésorier de la municipalité. (AB, 26)
1880 : Notre-Dame-du-Portage compte 98 familles et 170 enfants aux écoles. (EP, 122)
1881 : Pierre Caron devient maire pour la deuxième fois (AB, 26). La municipalité compte 734 habitants. Le recensement indique qu’aucun protestant n’y réside et que 50 familles anglaises y passent l’été comme touristes. (PL, 265)
1882 : Hubert Saint-Pierre remplace Pierre Caron à la mairie. (AB, 26)
1883 : David Hudon accède à la mairie. (AB, 26)
1885 : David Hudon est remplacé par Pierre Caron comme maire et devient secrétaire-trésorier de la municipalité. (AB, 26)
1887 : Hubert Saint-Pierre devient maire pour la seconde fois (AB, 26). En plus de l’Hôtel Labbé, le Portage compte maintenant deux autres établissements hôteliers : Mlle A. Michaud exploite l’Hôtel des Touristes et Georges Grondin, marchand général, accueille des visiteurs au cœur du village, là où on érigera plus tard l’Hôtel Boucher et où se trouve aujourd’hui le Domaine Porte-à-Joie. (PL, 266)
1889 : Pierre Caron entreprend un quatrième mandat comme maire (AB, 26).
1889 : Le 16 juin, Mgr Taschereau bénit le carillon de trois cloches dont est dotée l’église actuelle. Ces cloches furent fabriquées aux ateliers de la Maison Havard de Villedieu, en France, et importées par M. J.-A. Langlais de Québec. (EP, 124)
1892 : Louis Leclerc devient maire et G.-Arthur Grondin secrétaire-trésorier.
1892 : Installation dans la niche de la façade de l’église d’une sculpture en bois recouverte de plomb appelée la « Vierge blanche ». (EP, 126)
1894 : Auguste Robert, marchand de bois de Montréal, prend possession de sa nouvelle résidence d’été. La demeure de style néo-Queen Anne, construite sur un terrain acquis deux ans plus tôt de Napoléon Boulé de Rivière-du-Loup, est la plus élaborée du Portage, sur le plan décoratif. Elle est vendue en 1895 à madame Damase Bessette. En 1911, madame Joseph-Eugène Pelletier en fait l’acquisition (PL, 273). Pierre Boucher l’acquiert ensuite, avec l’aide de ses fils, il y annexe un édifice de trois étages, d’un style architectural beaucoup plus sobre et, en 1930, y ouvre le New Portage Inn. Il en confiera la gestion à son fils Robert qui en assurera la direction jusqu’en 1969. L’établissement existe toujours sous le nom d’Auberge du Portage.
1898 : Ferdinand Dickner est élu maire et Édouard Michaud est nommé secrétaire-trésorier. (AB, 26)
1901 : D’après le recensement, la population du Portage au 30 mars s’établit à 773 personnes, appartenant à 118 familles. La partie est, soit celle allant des limites de Rivière-du-Loup jusqu’au monument du Portageur compte 217 personnes ; on en dénombre 306 dans le secteur de Rivière-des-Caps (du Portageur jusqu’aux limites de St-André) et 254 au Chemin-du-Lac.
1907 : François Dionne devient maire (AB, 26).
1907 : Le 27 octobre, installation dans l’église de l’actuel chemin de croix, des peintures réalisées par Louis-Joseph St-Hilaire. (EP, 129)
1909 : Fernand Dickner est élu maire et Wilfrid Léveillé devient secrétaire-trésorier (AB, 26).
1916 : Jules Bernier est le nouveau maire (AB, 26).
1916 : Construction de l’Hôtel de la Plage par Stanislas Boucher. Après avoir étudié les beaux-arts à Paris et ne pouvant vivre de son art et encouragé par son père Pascal, il construit un hôtel qui demeure propriété de la famille Boucher jusqu’en 2006. Pendant l’hiver, Stanislas retrouve ses pinceaux. Homme aux multiples talents, il s’adonne aussi à la construction de bateaux et propose des croisières aux îles pendant l’été. (PL, 281)
1918 : Séjour à Notre-Dame-du-Portage de Marius Barbeau, célèbre anthropologue, ethnologue et folkloriste québécois. Il y recueille un grand nombre de chansons populaires, dont pas moins de 23 sont publiées dans ses livres Le Rossignol y chante, En roulant ma boule et Le roi boit. On y retrouve notamment des chansons recueillies auprès de Luc April, Alcide Léveillé, Joseph Fournier, Éveline Boucher (épouse de Luc April), Henriette Nadeau, Marguerite d’Arcourt et Napoléon Jean. Il recueille également des anecdotes populaires, dont plusieurs mettent en scène le Rocher Malin, auprès de Luc April et son épouse Éveline Boucher (tous deux alors âgés de 58 ans), Alcide Léveillé (73 ans), Henriette Nadeau née Duperré (98 ans) et Salomon Nadeau (87 ans) ; ces anecdotes sont publiées dans The Journal of American Folklore, vol. 33, July-September 1920, no. 129. (AO, 7)
1921 : Alphée Michaud occupe la fonction de maire (AB, 26). On recense 415 personnes au Portage. (PL, 289)
1921 : Le premier appareil téléphonique du Portage est installé chez Georges Larouche, du Chemin-du-Lac. (AB, 69)
1924-1925 : La route du Fleuve prend sa forme à peu près définitive. (AB, 19)
1928 : Louis-Étienne Pelletier est nommé secrétaire-trésorier (AB, 26). On installe l’électricité dans le village. Au Chemin-du-Lac, il faudra attendre les années 1940 pour l’électrification rurale. (AB, 69)
1929 : Les premières radios font leur apparition, en 1929 ou 1930, peu après l’installation de l’électricité (AB, 69)
1931 : Le recensement établit la population de la municipalité à 579 personnes, une diminution de 25 % en trente ans.
1931 : Pavage en asphalte d’une partie de la route du Fleuve. (AB, 19). La construction de la première route le long du Fleuve remonte au Régime Français. « Un chemin royal de vingt-quatre pieds de largeur, avec fossés latéraux, y est construit, dès le début de l’été 1746 ». (LS, p. 21)
1931 : Installation, à la limite est du village, d’une scierie, combinée à un atelier de planage et de menuiserie. Elle appartient à Jules Léveillé. Elle est incendiée en 1942. (AB, 49)
1932 : Bénédiction d’une croix de chemin au Chemin-du-Lac. (PL, 299)
1932 : La succursale de la Banque Provinciale du Canada située dans le magasin d’Arthur Anctil change d’emplacement ; elle est désormais située dans le magasin de Wilfrid D’Amours. Cette succursale sera en opération jusqu’en 1969. (AB, 69)
1933 : Louis Proteau accède à la mairie. (AB, 26)
1935 : Fondation du Cercle des fermières. (BB3, 10)
1938 : Installation d’une succursale de la Caisse populaire Desjardins. (BB2, 73)
1938 : La municipalité compte 65 cultivateurs propriétaires de ferme, dont 15 ne sont pas domiciliés, 56 propriétaires de maison, dont 33 sont non-résidents, un forgeron, un barbier, un boucher, un capitaine et un officier de navigation, 8 chauffeurs de taxi (cinq de ces taxis appartiennent à des hôteliers, deux à des cultivateurs et l’autre au forgeron), 4 institutrices, 60 à 70 femmes et jeunes filles en service domestique, une scierie combinée à un atelier de planage et de menuiserie, une gare, deux bureaux de poste, deux érablières, une douzaine d’apiculteurs, deux magasins généraux, un restaurant, sept grands hôtels, 2 pensions et 35 à 40 maisons particulières louées à des étrangers. (BB2, 63 et 68-74)1939 : Jean-Baptiste Dionne est élu maire. (AB, 26)
1940 : Alphée Michaud devient maire de nouveau. (AB, 26)
1941 : Joseph Leclerc entre à la mairie. (AB, 26)
1942 : Publication du livre de l’Abbé Edmond Pelletier, Album historique et paroissial de Notre-Dame-du-Portage, 1723 à 1940.
1945 : Louis-Étienne St-Pierre est élu maire et Roland Boucher devient le nouveau secrétaire-trésorier. (AB, 26)
1949 : Louis-Proteau III prend charge de la fonction de maire. (AB, 26)
1953 : Antonio Larouche entreprend un bref mandat comme maire. (AB, 26)
1954 : Elzéar Bernier est élu maire. (AB, 26)
De 1957 à 2021
1957 : Début des travaux de construction de l’aéroport. (AB, 19)1958 : Construction d’une voie de contournement du village. La voie de bifurcation devenue la route de la Montagne va assener un dur coup aux nombreux hôteliers, restaurateurs et commerçants. (PL, 305) On compte alors au Portage de nombreux établissements hôteliers : les Chalets Claire-Vue, l’Hôtel et les Chalets Pèlerins, l’Aiglon, le Portage Inn, Les Touristes, l’Hôtel Bienvenue, l’Hôtel Boucher, l’Hôtel de la Montagne, l’Hôtel de la Plage, l’Auberge sur Mer et l’Hôtel Léveillé.
1959 : Paul-Émile Dickner devient maire. Il occupera cette fonction jusqu’en 1974. (AB, 26)
1960 : Après la première journée d’école suivant la relâche des Fêtes, un incendie rase complètement l’école du village. Les enfants sont séparés en deux groupes pour leur permettre de poursuivre leur année scolaire à la sacristie et dans des maisons privées.
1961 : Ouverture de la nouvelle école primaire, sur la route du Fleuve, au centre du village.
1964 : À l’instigation d’Horel Boucher, Clermont Pelletier et Lucie Plante, ouverture de la boîte à chansons Au Pionnier dans la salle paroissiale située Place de l’église, entre le presbytère et l’école. Pierre Calvé est le premier artiste à s’y produire.
1965 : Formation du Centre d’art et de loisirs de Notre-Dame-du-Portage, une association coopérative qui s’installe dans la grange désaffectée d’Yvon Léveillé. On y déménage la boîte à chanson. Gilles Vigneault y chante lors de l’inauguration. Félix Leclerc, Pauline Julien, Pierre Dudan, les Karrick et nombre d’autres s’y produisent au cours de l’année. (PL, 319)
1965 : Début de construction de la piscine municipale, dans le cadre du programme des « travaux d’hiver ».
1966 : Ouverture de la piscine municipale, la seule piscine d’eau salée chauffée dans l’est du Québec.
1967 : Alors que Pierre Landry en est le gérant, la boîte Au Pionnier accueille Claude Dubois, Jacques Blanchet, Georges Dor, Ricet Barrier, Alexandre Zelkine, Louise Forestier et Robert Charlebois. (PL, 319)
1967 : Le 19 juillet, arrivée de 60 marcheurs des Fusiliers du Saint-Laurent participants à la Marche du Grand-Portage entre Edmundston (Nouveau-Brunswick) et Notre-Dame-du-Portage. Partis le 7 juillet d’Edmundston, ils ont franchi quelque 190 km habillés en coureurs des bois.
1972 : Jean-Hugues Normand est nommé secrétaire-trésorier. (AB, 26)
1974 : Gérard Landry devient maire. (AB, 26)
1975 : Le 29 juin, dévoilement du monument commémoratif « Le Portageur », au point d’accès de l’ancien sentier du Portage. Cet endroit marque l’extrémité nord-est du lieu-dit Rivière-des-Caps, où s’installèrent les premiers habitants de ce coin de pays au début du 18e siècle. Le monument est érigé à l’initiative de la Chambre de commerce de Notre-Dame-du-Portage. La base est faite de pierres fournies par le ministère des Transports du Québec et le travail de maçonnerie exécuté par l’entreprise Roland Dickner. Conçu par Joseph Dickner, le monument est l’œuvre de Jean-Marc de Courval de la Maison Art Déco.
1981 : Célébration du 125e anniversaire de la municipalité, sous le thème « Les retrouvailles ». Publication du livre de Laurent Saindon, Aux origines de Notre-Dame-du-Portage, et de celui du Comité central des Fêtes, Notre-Dame-du-Portage, 1856-1981.
1981 : Fermeture du quai. Il sera acquis par la municipalité et rénové en 1994-1995.
1982 : Le 4 janvier, le conseil municipal décide, à la suggestion de la Chambre de commerce, de demander au gouvernement fédéral de rouvrir le quai du Portage. Il faudra attendre l’année 1994 pour que le projet se réalise.
1982 : Le 25 mai, ouverture de la première bibliothèque municipale, au sous-sol du Centre d’art Le Béluga, alors propriété de la municipalité.
1982 : Louis-Marie Gagnon est élu maire.
1983 : La bibliothèque est déménagée dans la salle paroissiale, située entre l’école et le presbytère.
1984 : En février, installation dans l’église d’un orgue Casavant de 1910, à dix jeux, acquis du Monastère des Franciscains de la rue Alverne de Québec par la Fabrique, l’année précédente, pour la somme de 2 000 $.
1987 : Le 29 septembre, la charte d’affiliation du Club Optimiste de Notre-Dame-du-Portage est acceptée et le club est reconnu officiellement lors de l’assemblée du 2 novembre. Il mettra fin à ses activités en 1993.
1987 : Au cours de l’automne, construction de la caserne-incendie sur la route de la Montagne.
1988 : Gilles Moreau devient maire ; il occupera cette fonction jusqu’en 2005.
1990 : D’avril à septembre, construction du bureau municipal, attenant à la caserne-incendie sur la route de la Montagne.
1990 : Le 4 juin, le conseil municipal est informé qu’un comité stratégique de la Commission scolaire recommande la construction d’une nouvelle école et que la Commission sollicite l’aide de la Municipalité pour réaliser ce projet.
1992 : Le 1er janvier, Éric Bérubé devient secrétaire-trésorier de la municipalité.
1992 : Le 7 janvier, le conseil municipal accepte de céder gratuitement la salle paroissiale, évaluée à 100 000 $, à la Commission scolaire qui a besoin d’espace pour un gymnase. Elle décide également de faire un don de 30 000 $, pourvu que la Commission scolaire réserve des locaux à l’intérieur de la future école pour une bibliothèque municipale et des espaces de rangement. Le projet global de nouvelle école est évalué à un million de dollars. Toutefois, les plans préliminaires de la nouvelle école seront rejetés. On procédera plutôt à la rénovation de l’école actuelle au cours de l’été 1993.
1993 : Le 5 avril, ayant jugé trop élevé le coût du déménagement de la salle paroissiale, les autorités municipales décident de la faire démolir. Le 3 mai, leconseil municipal approuve le contrat de démolition au coût de 6 002,88 $. La bibliothèque est alors localisée temporairement au bureau municipal. Les travaux de rénovation de l’école et la construction du gymnase s’effectuent au cours de l’été.
1993 : Le 5 avril, le conseil municipal autorise la signature d’un protocole d’entente entre la Municipalité et le ministère des Travaux publics du Canada prévoyant la rénovation du quai et sa cession à la municipalité. Les travaux d’enrochement et de rénovation se réalisent au cours de l’hiver et de l’été suivants.
1994 : Les travaux de rénovation étant terminés, le quai devient de nouveau accessible.
1995 : Construction du nouveau Chalet des sports sur la côte de la Mer.
1995 : Le quai rénové est maintenant ouvert au public.
1996 : Le recensement établit la population résidant à Notre-Dame-du-Portage à 1 219 personnes.
1999 : Le 5 juillet, installation dans l’église de la « Vierge de Notre-Dame-du-Portage », sculpture sur bois réalisée par Clermont Gagnon de Saint-Jean-Port-Joli, d’après un dessin original de Geneviève Dick.
2001 : Le Portage compte 1 195 résidents.
2003 : En janvier, un comité de citoyens se met en place pour organiser une opposition au projet gouvernemental de regroupement de la ville de Rivière-du-Loup et de quatre municipalités environnantes, dont Notre-Dame-du-Portage. Une pétition est signée par la quasi-totalité des résidents. Le comité de citoyens élabore un rapport qui sera soumis à la Commission municipale du Québec en février. Le projet de regroupement sera abandonné suite à l’élection d’un nouveau gouvernement à Québec, en avril.
2003 : Le 22 février, Raphaële Lemieux, de Notre-Dame-du-Portage, est le porte-drapeau du Québec lors de l’ouverture des Jeux du Canada, à Bathurst, Nouveau-Brunswick. En patinage de vitesse, elle gagne la médaille d’or à l’épreuve du 1 000 mètres et la médaille d’argent à l’épreuve du 1 500 mètres. Elle y écrit l’histoire en devenant la première athlète à remporter des médailles d’or lors des Jeux d’été et d’hiver ; elle avait remporté la médaille d’or au critérium cycliste aux Jeux du Canada, à London, Ontario, le 14 août 2001.
2005 : Au cours de septembre, fermeture du seul dépanneur et casse-croûte de Notre-Dame-du-Portage.
2005 : Le 7 novembre, Nathalie Tremblay devient la première femme élue au poste de maire de la municipalité.
2006 : La population est estimée à 1 201 personnes.
2006 : Du 13 au 16 juillet, célébration du 150e anniversaire de la municipalité, sous le thème « Hier, aujourd’hui et demain ». Publication du livre de Pierre Landry, Une histoire de Notre-Dame-du-Portage.
2006 : Le 11 novembre, le nom de la municipalité change : la « municipalité de paroisse de Notre-Dame-du-Portage » devient la « Municipalité de Notre-Dame-du-Portage ».
2007 : Le 19 janvier, émission de la charte de Patrimoine et Culture du Portage, organisme sans but lucratif poursuivant trois missions : (1) promouvoir la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel de Notre-Dame-du-Portage ; (2) soutenir des activités à caractère culturel ou historique destinées aux résidents et visiteurs, et (3) aider les enfants de Notre-Dame-du-Portage ayant des besoins spéciaux dans le cours de leur éducation.
2007 : Dans le cadre des Fêtes de juillet, organisées par Patrimoine et Culture du Portage, le repas communautaire du 21 juillet, au Chalet des sports, est suivi d’une soirée de chants, animée par Bernard April, entrecoupée par les contes de Rémi Bourgoin et Pierre Dufort. Le 22, une excursion à caractère patrimonial commentée par Pierre Landry est effectuée à la rivière Fouquette et dans le secteur de Rivière- des-Caps. Ces fêtes comprennent également un marché champêtre et un marché aux puces, une criée à l’ancienne et un concert du quatuor à cordes La Tournée.
2008 : Le 15 janvier, Éric Bérubé quitte sa fonction de directeur général et est remplacé, sur une base intérimaire, par Annie Lemieux qui sera plus tard confirmée dans ce poste.
2008 : Le 17 février, Jean Simard, président de la Société québécoise d’ethnologie, et Mélanie Milot, coordonnatrice à la culture et au patrimoine à la MRC de Rivière-du-Loup, présentent une conférence sur le patrimoine religieux de Notre-Dame-du- Portage. C’est la première d’une série de conférences sur le thème « Découvertes d’ici et d’ailleurs », organisées par Patrimoine et Culture du Portage. Elle sera suivie, le 5 mai, de la causerie de Louise Plante, journaliste au quotidien Le Nouvelliste de Trois-Rivières, intitulée «Dix jours en Afghanistan », de celle de Maurice Fallu-Landry sur la navigation maritime, le 26 octobre, et d’une rencontre, le 23 novembre, avec Laura-Lou Fortin, jeune auteure du livre Projet ambiphémure.
2008 : Le 24 juin, lors du dîner champêtre de la Fête nationale préparé par la municipalité, Pierre Landry prononce une conférence sur l’histoire de Notre-Dame-du-Portage. En soirée, un groupe de musiciens et chanteurs, sous la direction de Bernard April, présente un spectacle sur le quai ; le traditionnel feu sur la grève suit l’événement.
2008 : Au cours de la saison estivale, à l’initiative de Patrimoine et Culture du Portage, quatre familles ouvrent pendant un après-midi leur jardin aux visiteurs.
2008 : Dans le cadre des Fêtes de juillet, des excursionnistes se rendent en Zodiac, le 13, contourner les îles Pèlerins pendant que Pierre Landry leur raconte l’histoire et des anecdotes liées à ces îles ; le quatuor à cordes La Tournée présente le 20 son concert « Promenades méditerranéennes » ; le 25, un « 5 à 7 » musical et littéraire permet d’assister aux prestations des jeunes Vivaldistes de la région et du Chœur Robert-Schuman, un ensemble composé de représentants de quatre pays européens, ainsi qu’au lancement du livre de Cécile Bibaud, Marie-Jeanne. Cet événement est suivi d’une soirée de cinéma en plein air.
2008 : Le 26 juillet, le Chœur Robert-Schuman vient agrémenter les marchés à la Place de l’église et présente de plus dans l’église, en soirée, grâce à la collaboration du Camp musical Saint-Alexandre, un concert de chants de divers pays.
2008 : Pendant l’automne, une enquête orale à caractère historique permet d’interviewer seize personnes ayant participé ou été des témoins privilégiés du développement de la municipalité au cours du vingtième siècle. Cette enquête est conduite par Patrimoine et Culture du Portage, en collaboration avec le Module d’histoire de l’Université du Québec à Rimouski. Elle vise à identifier les principaux événements ayant marqué le siècle dernier au Portage.
2008 : Le 3 novembre, la vice-première ministre et ministre des Affaires municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau, annonce l’attribution d’une aide gouvernementale de l’ordre de 1 396 190 $ à la municipalité, en vertu du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités ; cette aide servira à la réalisation de travaux d’infrastructures en eau dans le secteur du Parc de l’Amitié.
2009 : La programmation de « Découvertes d’ici et d’ailleurs » offre deux conférences avant l’été, la première sur « Marius Barbeau au Portage en 1918 », présentée le 25 janvier par Aubert Ouellet, et l’autre sur « Le rallye Aïcha des Gazelles au Maroc », donnée le 19 avril par Pascale Brouillette, qui a effectué le rallye en 2005.
2009 : Le 4 avril, un incendie détruit l’Hôtel de la Plage, un édifice patrimonial. Cet hôtel fut construit en 1915 par Pascal et Stanislas Boucher ; ce dernier le dirigea pendant plusieurs années. Il est demeuré une entreprise de la famille Boucher jusqu’en 2006.
2009 : Le 24 juin, après le dîner champêtre de la Fête nationale organisé par la Municipalité, la mairesse, madame Nathalie Tremblay, procède à l’inauguration de trois tables d’interprétation du patrimoine produites par l’Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup et élaborées par Patrimoine et Culture du Portage.
2009 : Les 10 et 11 juillet, un groupe de musiciens et chanteurs, animé par Horel Boucher, fait revivre l’ancienne boîte Au Pionnier, lors de spectacles du Groupe Hommage à quelques chansonniers québécois ayant marqué les belles années des boîtes à chansons (Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Claude Léveillée, Jean-Pierre Ferland, Pierre Calvé, Claude Gauthier et Raymond Lévesque). Les spectacles sont présentés dans le gymnase de l’école, soit l’endroit où se trouvait l’ancienne salle paroissiale où s’est d’abord installée la boîte à chansons Au Pionnier, au cours de sa première année d’existence en 1964.
2009 : Lors d’un « 5 à 7 » au Chalet des sports le 20 juillet, on procède au dévoilement de treize tables d’interprétation du patrimoine et de l’histoire de la route du Fleuve. Ces tables, produites par Patrimoine et Culture du Portage, sont installées au cours de la semaine suivante.
2009 : Le 1er novembre, Louis Vadeboncoeur est élu maire.
2009 : Première édition de la Course du Portageur sur la route du Fleuve, offrant des parcours de un, cinq et dix kilomètres.
2010 : Le 9 juin, Patrimoine et Culture du Portage reçoit le prix du Patrimoine de la MRC de Rivière-du-Loup, dans la catégorie « Transmission, interprétation et diffusion », pour les tables d’interprétation du patrimoine et de l’histoire de la route du Fleuve, produites et installées au cours de l’été 2009.
2010 : En juin, installation de quatre tables additionnelles d’interprétation sur la route du Fleuve. Le parcours patrimonial compte maintenant vingt tables d’interprétation.
2010 : Les 2 et 3 juillet, soirées musicales du Groupe Hommage. Cette année, le programme comprend l’interprétation de chansons de six artistes francophones d’Europe : Aznavour, Brel, Brassens, Piaf, Moustaki et Reggiani.
2010 : Le 24 septembre, dévoilement officiel de « La dame du Portage », une sculpture monumentale de l’artiste québécois Jacques Dansereau, installée devant l’édifice municipal.
2010 : Le 3 novembre, assemblée de fondation de la Corporation portageoise de développement.
2010 : Le 14 novembre, deuxième édition de la Course du Portageur.
2010 : Le 6 décembre, les grandes marées dynamisées par de forts vents du nordet, sous une température pluvieuse et une pression atmosphérique basse, causent des dommages importants à plusieurs maisons et chalets, de même qu’à la route du Fleuve.
2011 : Les 9 et 10 juillet, les soirées musicales du Groupe Hommage présentent cette année l’interprétation des œuvres de cinq auteurs, compositeurs et chansonniers québécois : Diane Dufresne, Daniel Lavoie, Michel Rivard, Claude Dubois et Paul Piché.
2011 : Le 6 novembre, troisième édition de la Course du Portageur.
2012 : Les 6 et 7 juillet, le Groupe Hommage présente le spectacle « Légendes du St-Laurent et Musique celtique », avec le conteur Jocelyn Bérubé et le groupe musical La Bourrasque celtique.
2012 : Le 11 août, l’ancienne école de l’Anse-du-Portage, qui fut déménagée en septembre 1961, retourne dans son environnement d’origine. Ce projet, parrainé par l’organisme Patrimoine et Culture du Portage, vise à sortir de l’ombre un bâtiment patrimonial, pour en faire un poste d’accueil dans le parc de l’Anse-du-Portage et un centre d’exposition sur le patrimoine et l’histoire de Notre-Dame-du-Portage.
2012 : Le 1er octobre, début des travaux visant à doter le cœur du village d’un réseau d’aqueduc. Le coût du projet est évalué à 5 442 872 $.
2012 : Le 4 novembre, quatrième édition de la Course du Portageur.
2013 : Le 11 mars, lors d’une conférence de presse, annonce d’une subvention pour les travaux d’aqueduc du village.
2013 : Le 31 mai, départ d’Annie Lemieux, directrice générale de la municipalité depuis 2008.
2013 : Le 3 juin, Louis Breton entre en fonction comme directeur général de la municipalité.
2013 : le 24 juin, ouverture officielle de l’École de l’Anse. On y retrouve des cartes anciennes montrant l’ancien « chemin du Grand-Portage », des livres et du matériel scolaire utilisés par les élèves de niveau primaire avant 1960. On y présente au cours de l’été une vidéo sur l’histoire de la municipalité.
2013 : À compter de la Fête nationale jusqu’au 15 septembre à l’École de l’Anse, chaque samedi et dimanche, récit présenté par Jean-Marie Deschênes portant sur le voyage de Québec à Port-Royal effectué, en 1686, par Mgr de Saint-Vallier. En outre, tous les mercredis soir, présentation d’un concert à l’extérieur de l’École.
2013 : Élu par acclamation, Vincent More est assermenté comme maire le 11 octobre.
2013 : À la fin d’octobre, les travaux d’aqueduc au centre de la route du Fleuve sont complétés.
2013 : Le 2 novembre, cinquième édition de la Course du Portageur ; près de 600 personnes y participent.
2014 : Au cours des mois d’été, l’École de l’Anse présente une reconstitution historique mettant en vedette Jean-Baptiste Long (personnifié par Jean-Marie Deschênes), un acadien ayant assuré pendant plusieurs années le transport du courrier entre Québec et Halifax et emprunté assidûment le chemin du Portage dans le cours de son travail. Des concerts en plein air sont aussi proposés les mercredis de beau temps, en soirée.
2017 : Vincent More est réélu maire pour un second mandat.
2018 : Une nouvelle exposition est offerte à la petite École de l’Anse. Cette exposition porte sur “Les grandes vacances”, le coté villégiature de Notre-Dame-du-Portage. En collaboration avec le Musée du Bas-St-Laurent et la MRC de Rivière-du-Loup.
2018 : Les concerts du couchant offerts le mercredi se déplacent vers l’îlot paroissial.
2019 : Le chemin du Portage se dissocie de Patrimoine et Culture du Portage et devient un organisme indépendant. Il aura maintenant l’appellation: l’Association patrimoniale du Chemin du Portage. Pour le moment, Sylvie Côté en est la présidente.
2021: Inauguration du “Centre d’Interprétation du Chemin du Portage” dans la petite École de l’Anse.
Bibliographie
(AB), BOUCHER, André et coll., Notre-Dame-du-Portage, 1856-1981, Comité central des Fêtes du 125e, 1981, 72 p.(AO), OUELLET, Aubert, « Marius Barbeau à Notre-Dame-du-Portage », dans Histoire Québec, vol. 13, n° 3, p. 5-15.
(BB1), BÉRUBÉ, Beauvais, Rivière-du-Loup, Lointains Commencements, Longs Cheminements, Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, 1993
(BB2), BROUILLETTE, Benoît et coll., Inventaire des ressources naturelles et industrielles 1938, Comté municipal de Rivière-du-Loup, Québec, Ministère des Affaires municipales, de l’Industrie et du Commerce, 1939, 285 p.
(BB3), BROUILLETTE, Benoît et coll., Inventaire des ressources naturelles, 1938, Comté municipal de Rivière-du-Loup, section artisanale, Ministère des Affaires municipales, de l’Industrie et du Commerce, Québec, 1939, 13 p.
(EP), PELLETIER, Edmond, Album historique et paroissial de Notre-Dame-du-Portage, 1723 à 1940, Les ateliers de l’imprimerie provinciale, 1942, 367 p.
(JO), OUELLET, Jeannine, C’est notre histoire... Saint-André-de-Kamouraska, Comité des Fêtes du Bicentenaire, 1991, 723 p.
(LS), SAINDON, Laurent, Aux origines de Notre-Dame-du-Portage, 1981, 92 p.
(PL), LANDRY, Pierre, Une histoire de Notre-Dame-du-Portage, Éditions Trois-Pistoles, 2006, 333 p.
(PLM), MARTIN, Paul-Louis et coll., Rivière-du-Loup et son portage, Québec, La Documentation québécoise, 1977, 181 p.
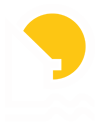 Municipalité de Notre-Dame-du-Portage
Municipalité de Notre-Dame-du-Portage